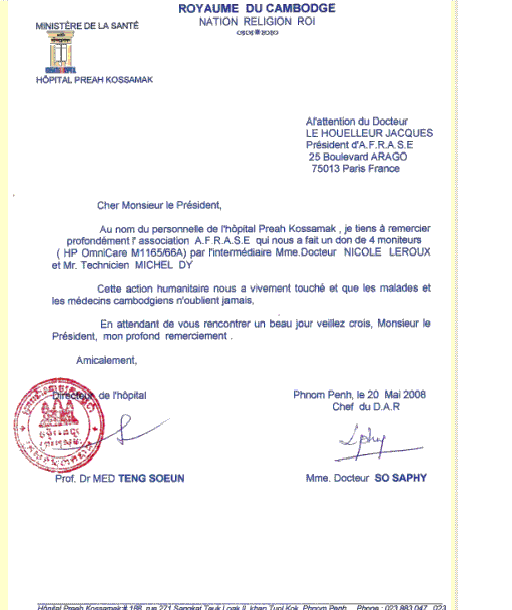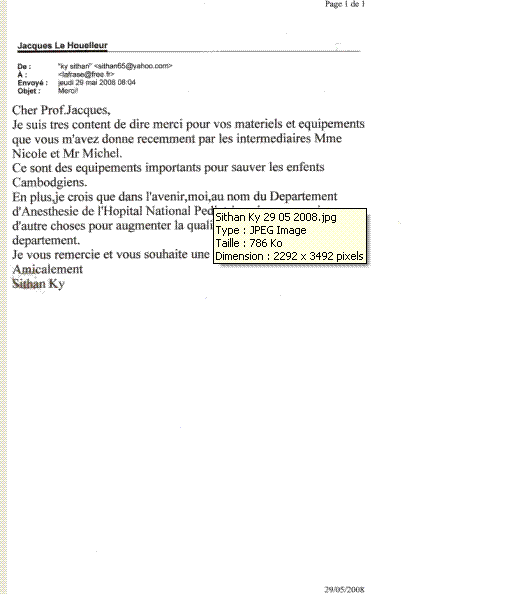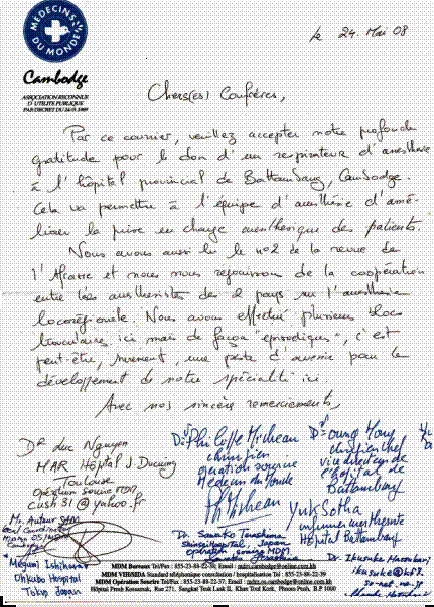14ème mission Muse Dr Eric Buy
Vendredi 22 mai 2009                      Cr Dr Eric Buy mission Muse à l’Hôpital Kossamak
Description du service d’anesthésie-réanimation et des urgences
Equipement  global du bloc opératoire
Le bloc opératoire comporte 5 salles d’opérations dont quatre fonctionnelles, la cinquième est une salle pour les petites urgences.
En ce qui concerne la distribution des fluides, seul l’oxygène est disponible. Il n’y a ni aspiration murale, ni air comprimé, ni protoxyde d’azote. La distribution de l’oxygène n’est pas continue. Le pourcentage d’oxygène n’est pas connu, ni contrôlé.
L’électricité est installée dans toutes les salles, mais il n’existe pas de groupe électrogène ou batteries de secours. Les coupures de courant sont fréquentes et de durée variable.
Des lavabos sont présents dans les sas d’entrée des salles. Ils ne sont pas entretenus. Le lavage chirurgical des mains se fait avec de l’eau non filtrée.
Le matériel d’anesthésie
Chaque salle est équipée d’un respirateur type Monnal avec moteur électrique. Un seul d’entre eux est équipé d’une cuve d’halothane. En cas de coupure de courant les patients sont ventilés manuellement avec un ballon. Dans plusieurs salles, on note la présence d’extracteur d’O2 en cas de panne de la distribution centrale d’O2.
La surveillance cardio-respiratoire est assurée par des moniteurs HP type MERLIN. Mais les câbles ECG, brassards à tension, ou capteurs de saturation en O2 sont souvent défectueux.
Il n’y a ni analyseur de gaz ni capnomètre au bloc.Â
MĂ©dicaments disponibles
Anesthésie : Thiopental, Kétamine, Fentanyl, Norcuron, Halothane
ALRÂ : XylocaĂŻne, MarcaĂŻne Hyperbare
Analgésie : Paracétamol (PO), Kétorolac, Morphine absente*
Antibiothérapie prophylactique: Flagyl, Ciflox, Ceftriaxone
Les techniques d’anesthésie utilisées
AnesthĂ©sie gĂ©nĂ©raleÂ
Les techniques d’anesthĂ©sie gĂ©nĂ©rale sont celles dĂ©veloppĂ©es en milieu difficile. C’est-Ă -dire l’anesthĂ©sie intraveineuse par rĂ©injection de Thiopental ou de KĂ©tamine.  La ventilation assistĂ©e en circuit ouvert entraĂ®ne un coĂ»t Ă©levĂ© en dĂ©pense d’oxygène et surtout  l’utilisation minimum  des gaz halogĂ©nĂ©s pour l’entretien de l’anesthĂ©sie. Ceci dit on remarque une grande habilitĂ© des anesthĂ©sistes pour  manier ces techniques d’anesthĂ©sie par rĂ©injection IV.Â
Anesthésie loco- régionale
L’anesthésie locorégionale est limitée essentiellement à la rachianesthésie. Mais les anesthésistes suivent les formations de l’Afrase sur les différentes techniques d’anesthésies locorégionales. Néanmoins l’absence de matériel et l’absence de Marcaïne isobare limitent l’utilisation de ces techniques.
La salle de réveil
La salle de réveil sert, avant toutes choses, d’entrepôt au matériel tombé en panne. Le local est mal entretenu, les surfaces sont poussiéreuses.
3 postes de surveillance HP « Merlin » avec monitorage de la SAO2 sont installés. Mais les capteurs et les câbles sont souvent défectueux. Il y a 2 respirateurs fonctionnels (Monnal et Osiris).
La surveillance postopératoire des patients reste essentiellement clinique. Ceci est acceptable pour les patients sous rachianesthésie. Les techniques d’anesthésie générale par réinjections intraveineuses ne permettent pas toujours une extubation précoce. La surveillance d’un patient intubé, ventilé nécessite au minimum un monitorage hémodynamique fiable et la surveillance de la saturation. La sécurité des patients est fortement dégradée par l’absence de maintenance du matériel et le manque chronique des dispositifs comme les câbles ECG, brassards de tensiomètres ou encore les capteurs SAO2.
Lors de mes deux visites de la salle de réveil, je n’ai vu aucun patient y séjourner, aucune infirmière ne paraissait être affectée à la salle de réveil.
Au total pour l’anesthésie :
Pour la chirurgie urologique, la chirurgie générale sous ombilicale, la chirurgie gynécologique et la chirurgie orthopédique des membres inférieurs,  la rachianesthésie semble la technique la plus utilisée à juste titre : elle est la moins coûteuse et nécessite une surveillance postopératoire minimum (clinique).
Pour les interventions orthopédiques des membres, l’enseignement des techniques d’ALR par l’Afrase devrait permettre une prise en charge peu coûteuse, nécessitant également une surveillance postopératoire minimum. Le problème est la disponibilité du matériel (aiguilles de neurostimulation), des anesthésiques locaux à durée prolongée (Bupivacaïne, Ropivacaïne).
Pour les autres chirurgies, les mĂ©decins anesthĂ©sistes font au mieux ! Les techniques d’anesthĂ©sie gĂ©nĂ©rale par rĂ©injections intraveineuses successives paraissent appropriĂ©es aux Ă©quipements disponibles peropĂ©ratoires et postopĂ©ratoires. Â
La pratique de la chirurgie du rachis dans ces conditions ne peut que susciter l’admiration des médecins occidentaux.
Néanmoins les chirurgiens ont dû renoncer à certaines chirurgies lourdes comme la chirurgie de l’œsophage ou la chirurgie thoracique pour des raisons d’absence de compétence anesthésique (intubation sélective) et d’insuffisance du plateau technique postopératoire.
La prise en charge de la douleur postopératoire
La prise en charge de la douleur postopératoire est quasi-inexistante. Les antalgiques de classe 1 (paracétamol et anti-inflammatoire) sont disponibles mais peu utilisés. Ceux de classe 2 ou de classe 3 (morphine) sont inexistants ou indisponibles. L’analgésie locorégionale n’est pas pratiquée.
Tout reste à faire. Les anesthésistes ne semblent pas encore sensibilisés par l’importance de la gestion de la douleur dans le processus de soins.
L’unité de soins intensifs
Cette unité comporte deux salles dont une climatisée qui vient d’ouvrir. Deux unités de 5 lits de réanimation polyvalente, 3 respirateurs et des moniteurs cardiorespiratoires « Merlin » sont disponibles. On note la possibilité récente de faire de la ventilation non invasive.
Le Dr So Saphy dirige et s’occupe médicalement de l’unité. Des médecins de garde assurent la continuité médicale 24h/24h. Ces médecins ne sont pas anesthésistes-réanimateurs mais possèdent des compétences en réanimation même si le niveau paraît peu élevé. 3 ou 4 infirmières sont affectées à la réanimation.
Les patients admis sont :
-         Les polytraumatisés dont ceux nécessitant une surveillance neurologique rapprochée ou une ventilation mécanique.
-        Les patients postopératoires devant être ventilés.
-        Les patients présentant un sepsis grave (péritonite).
-        Les urgences médicales: décompensation respiratoire (BPCO, infection pulmonaire grave), hémorragie digestive grave…
La seule technique de suppléance disponible est l’assistance respiratoire mécanique. Il n’y a pas d’air comprimé ni de vide. Les antibiotiques sont utilisés de façon probabiliste. Aucun soin infirmier n’est protocolisé.
Les résultats sont à la mesure des moyens: si un patient est intubé pour une défaillance viscérale…il meurt dans la plupart des cas.
La famille accompagne le malade durant son hospitalisation. Elle le nourrit, le lave, le masse. La promiscuité est maximale. L’hygiène est déplorable mais s’améliore grâce au travail de Céline, interne d’anesthésie-réanimation, qui a introduit l’utilisation des solutions hydro-alcooliques.
Le service des urgences
Le service des urgences est le pilier central du recrutement de l’hôpital Preah Kossamak. Il accueille essentiellement des polytraumatisés, accidentés de la route. Il alimente le service d’orthopédie et de neurochirurgie. L’hôpital  Kossamak reçoit aussi des urgences de chirurgie générale et gynécologie, des urgences de gastro-entérologie et de pneumologie.
Locaux
Les patients sont admis avec leur famille dans une salle commune de 50 m2. Ce local peut accueillir jusqu’à 6 patients environ. Les locaux sont peu entretenus, la promiscuité est maximale. Le manque d’hygiène est un réel problème. L’absence d’ascenseur empêche le transfert des patients vers les services spécialisés situés en étage. Ceci entraîne une accumulation des patients aux urgences.
Accueil.
Des médecins généralistes prennent des gardes. Leurs connaissances de la médecine d’urgence semblent limitées. Le médecin de garde examine le patient, fait le diagnostic. Les orthopédistes, neurochirurgiens, chirurgiens généralistes, ou médecins spécialistes sont appelés pour avis. Les données cliniques sont notées dans le dossier.
Matériel d’urgence
Il n’y a pas de chariot d’urgence. Un défibrillateur fonctionnel est disponible, ainsi qu’un laryngoscope. Les médicaments nécessaires au traitement d’ACR (adrénaline) ne sont pas disponibles.
Transfusion
La distribution de sang est centralisée. Le produit le plus utilisé est le sang total. Le prix est 80 USD par flacon. Le flacon est gratuit si un membre de la famille donne son sang en échange.
Le plateau technique
Biologie: accès 24h/24 à un bilan biologique minimum et au groupage du patient. Pas de RAI.
Bactériologie: actuellement les prélèvements sont envoyés à Pasteur. Il existe un projet de laboratoire de bactériologie.
Radiologie: il existe un service de radiologie avec 2 salles de radiographie standard. Pas d’appareil mobile pour les radiographies au lit du malade. Un appareil d’Ă©chographie neuf a Ă©tĂ© achetĂ© par l’hĂ´pital.
Scanner : l’absence de scanner dans l’hôpital pose un réel problème pour les patients polytraumatisés. Cet examen est disponible dans le secteur privé ou à l’Hôpital Calmette. Les neurochirurgiens exigent à juste titre un TDM cérébral pour opérer. Un scanner sans injection coute 90 USD et un scanner avec injection 120USD. Ce prix est inaccessible pour la plupart des familles cambodgiennes.
Transport: Le touk-touk est le moyen de transport et de transfert des patients et ce quelque soit leur état !
Proposition d’action en Anesthésie, aux soins intensifs et aux urgences.
Quatre axes majeurs pour notre action :
-        L’hygiène: un hôpital propre, des mains propres.
-        Maintenance active du matériel: du matériel simple, fiable que l’on peut réparer sur place.
-        Former le personnel sur place: de la femme de ménage au médecin.
-        Durabilité économique de nos actions.
Bloc opératoire et salle de réveil :
Mesures immédiates :
-        Hygiène et nettoyage des locaux (travailler avec ARAS).
-        Contrôle de la stérilisation.
-        Maintenance du matériel (projet atelier biomédical).
-        Fournir des câbles ECG, tensiomètres, capteur SAO2 pour augmenter la sécurité des patients.
-        Soutenir l’action de l’AFRASE pour développer l’ALR.
-        Améliorer la prise en charge de la douleur postopératoire: établir des protocoles postopératoires tenant compte de la disponibilité des médicaments et autres DM.
-        Rationaliser l’utilisation péri opératoire des antibiotiques.
Thématiques secondaires :
-        Faire évoluer les techniques d’anesthésie générale: dans l’état actuel des équipements, les seules améliorations possibles seraient:
o      l’introduction du Propofol pour l’anesthésie intraveineuse (problème de coût à étudier) qui permet des réveils rapides.
o     Développer les techniques d’anesthésie mixte: anesthésie générale et péridurale ou bloc périphérique.
Soins intensifs :
-        Mise place de protocoles de soins de base de réanimation.
-        Formation de premières infirmières (chargée d’enseigner dans le service ces protocoles).
-        Mise en place d’une formation pour les médecins (voir avec Dr Fabienne Plouvier).
Â
Â
Service des Urgences
-        Travail sur l’hygiène.
-        Mise en place d’un chariot d’urgence.
-        Mise en place de protocole d’évaluation des polytraumatisés.
-        Arbre décisionnel pour l’indication des scanners.
-        Améliorer la sécurité des transports inter-établissement.
-        Formation des médecins et infirmiers à la gestion de l’arrêt cardiaque ou autres.
-        Formation d’une équipe mobile pour les urgences intra hospitalières, mise en place d’un système d’alerte.
Â
NB : Opportunité de la présence d’un interne urgentiste lyonnais de mai à Novembre